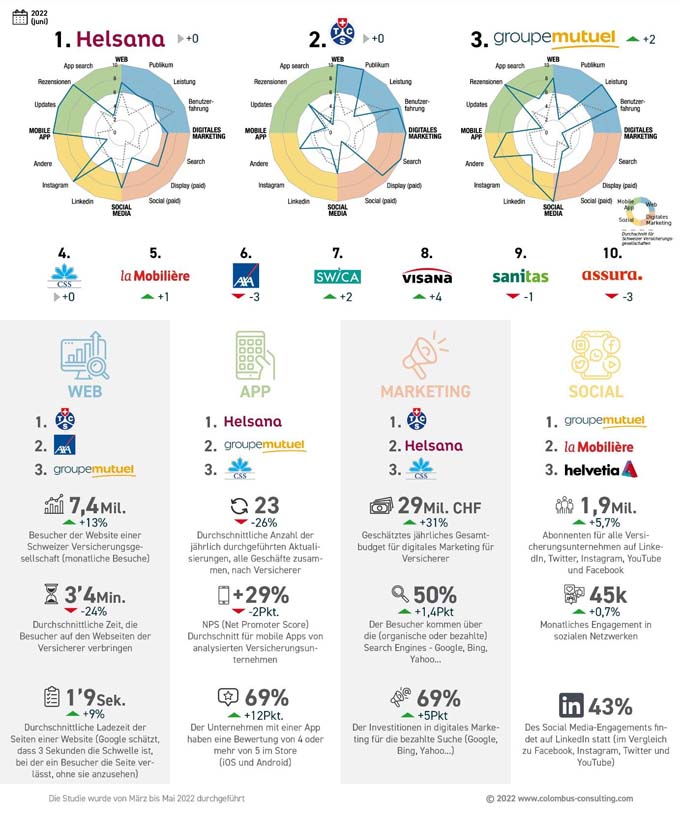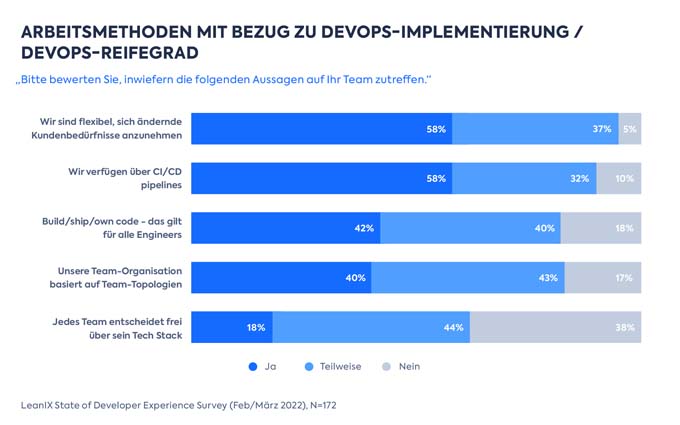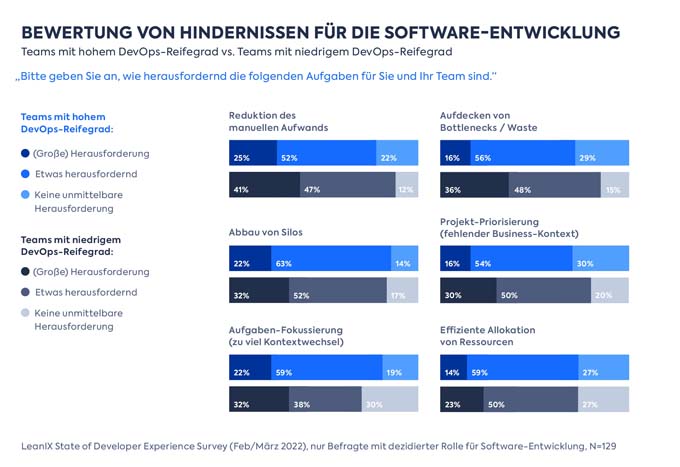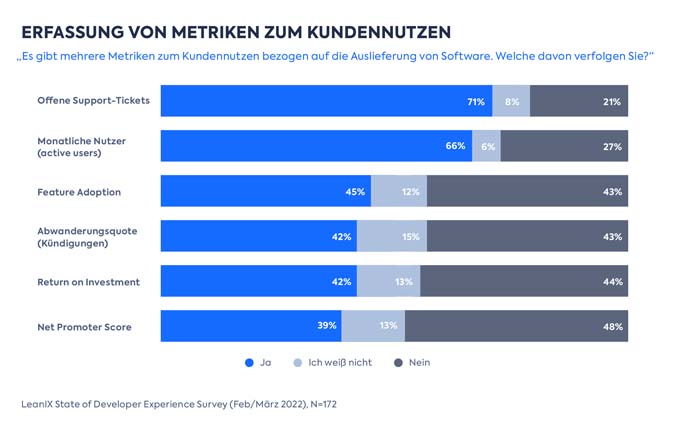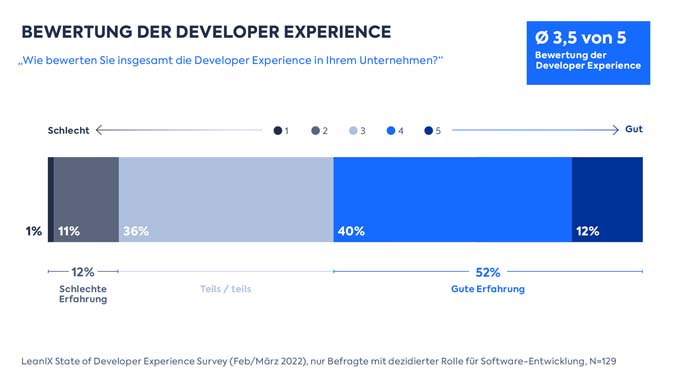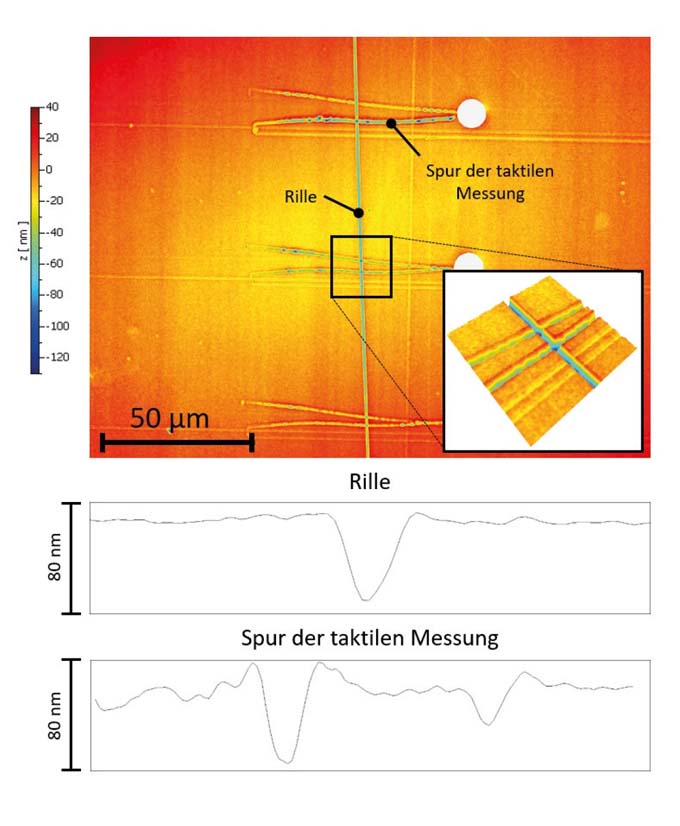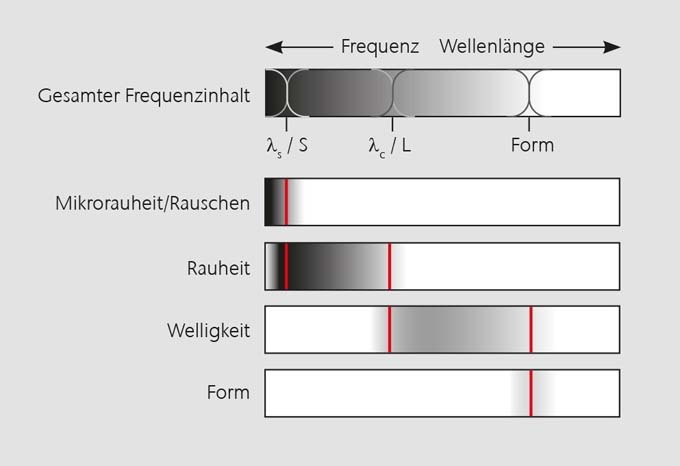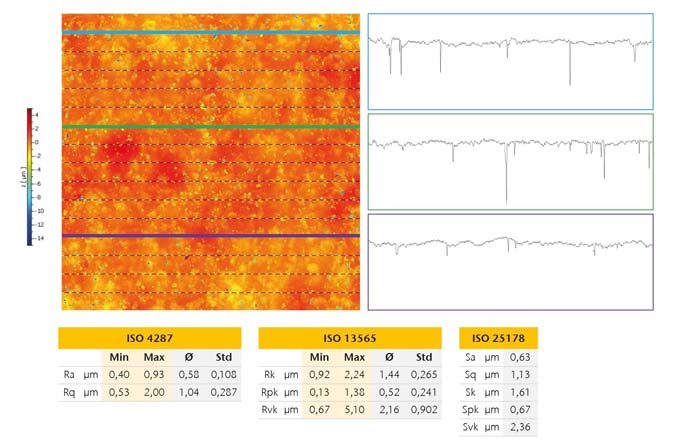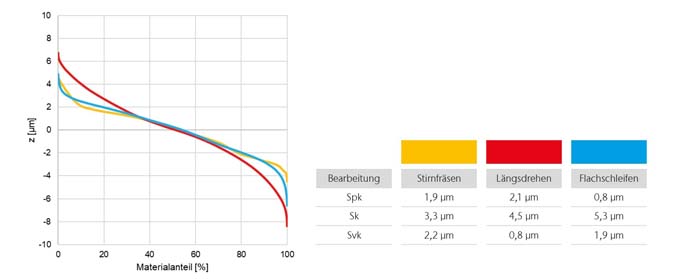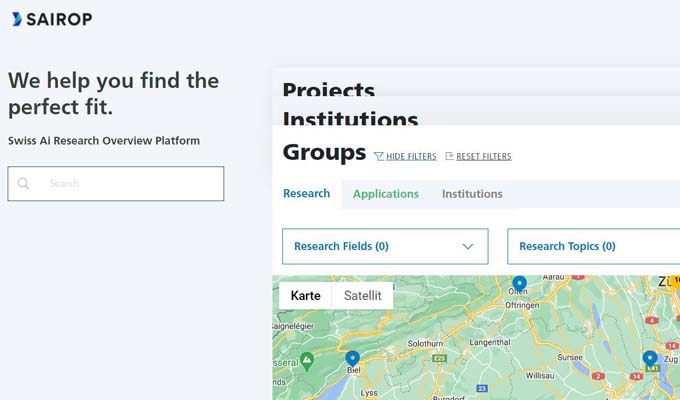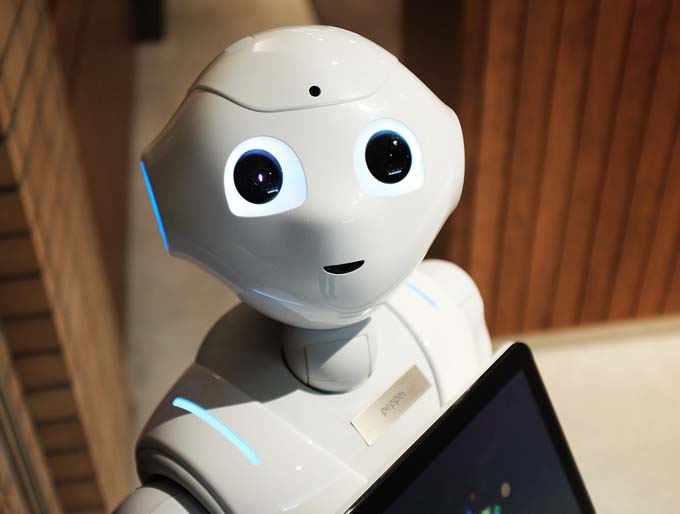Neuf conseils pour mettre en place un modèle de gouvernance des données efficace
Vous souhaitez exploiter pleinement le potentiel des données dans votre entreprise ? Une stratégie de gouvernance des données efficace est alors indispensable. Celle-ci garantit non seulement que les données circulent sans problème dans tous les départements de l'entreprise, mais elle préserve également la qualité, l'accessibilité, l'utilisabilité et la sécurité des informations.

Avant de s'appuyer entièrement ou partiellement sur des analyses pour la prise de décisions stratégiques, il faut d'abord mettre en place des processus appropriés. Cela garantit que les données circulent sans problème dans tous les départements de l'entreprise et que leur qualité, leur accessibilité, leur utilisabilité et leur sécurité sont préservées.
Vous trouverez ici neuf conseils pour mettre en place une stratégie de gouvernance des données efficace.
1. vérifier les stocks de données dans l'entreprise
Pour tirer le meilleur parti des données, les parties prenantes doivent savoir comment les sélectionner, les collecter, les stocker et les utiliser efficacement. Faites l'inventaire de toutes les données disponibles dans l'entreprise et identifiez leurs différentes sources, telles que les systèmes de gestion, les sites web, les réseaux sociaux et les campagnes de marketing et de publicité. Ensuite, définissez les points de friction où la mauvaise qualité des données entraîne une perte de valeur.
Soyez particulièrement attentif aux points suivants :
- Volume: La quantité de données a explosé ces dernières années. Déterminez le nombre d'informations stockées dans vos bases de données afin de définir votre méthode de gestion des données.
- DiversitéLes données peuvent être complexes et variées, structurées ou non, et provenir d'un large éventail de systèmes d'information. Saisissez-les à différents endroits, centralisez-les et rapprochez-les afin d'obtenir une représentation complète de toutes les informations.
- RapiditéMisez sur des logiciels puissants et flexibles qui intègrent l'apprentissage automatique. Examinez votre infrastructure pour choisir les outils les plus efficaces qui répondent à vos besoins et établissez une base technique solide.
- Vérité: Les erreurs d'explication dans les formulaires, la multiplicité des points de saisie, les actions de bots, les actes de malveillance, les erreurs humaines et bien d'autres choses encore mettent en péril les fondements des données. Des distorsions peuvent également survenir lors de l'analyse. Réalisez donc un diagnostic de la qualité et de la précision de vos données.
- ValeurLes données que vous utilisez doivent être parfaitement alignées avec les objectifs commerciaux et marketing de votre entreprise et créer de la valeur à la fois pour la marque et pour vos clients. Unifiez les données et réagissez rapidement pour être du côté des gagnants.
2. mettre en place une stratégie de gouvernance des données unifiée
Tous les services de l'entreprise doivent être impliqués dans l'utilisation des données, de la direction aux chefs d'équipe, en passant par les équipes d'exploitation et les équipes de terrain. L'ensemble du personnel doit comprendre les enjeux et les avantages de données partagées et de qualité. Prenez en compte les points suivants pour impliquer l'ensemble de l'entreprise dans cette transition :
- des entretiens individuels ou de groupe avec les différents services afin de mieux comprendre la situation actuelle en matière de données, d'identifier les exigences organisationnelles et de prendre en compte toutes les attentes en matière de gouvernance des données.
- Ateliers visant à développer ensemble un cadre méthodologique global pour l'introduction de la gouvernance des données.
- Cas d'utilisation réels dans lesquels, avec l'aide d'un certain nombre de collaborateurs, un problème commercial lié à un domaine de données spécifique est analysé. Dans le secteur du commerce électronique, il pourrait s'agir par exemple d'erreurs dans les dimensions des emballages de produits, qui entraînent des difficultés logistiques et l'abandon de l'achat parce que le client constate des frais de livraison trop élevés.
Définissez ensuite des objectifs stratégiques qui s'appliquent à l'ensemble de l'entreprise ou à certains secteurs d'activité. Définissez ensuite tous les indicateurs de performance de l'organisation afin que chacun comprenne son rôle dans le modèle de gouvernance.
3. choisir un modèle de gouvernance des données approprié
Lorsque vous lancez un projet de gouvernance des données, ne tombez pas dans le piège de vouloir répondre simultanément à toutes les questions techniques, organisationnelles et réglementaires. Vous avez besoin de temps pour obtenir les premiers résultats tangibles. Établissez une feuille de route précise, validée par les parties prenantes, avec des objectifs intermédiaires pour évaluer les efforts et les progrès réalisés jusqu'à présent.
N'oubliez pas non plus qu'il existe différents modèles de gouvernance des données. Choisissez celui qui convient le mieux à votre environnement, à vos besoins, à vos ressources humaines et financières et à la maturité de vos données.
4. identification et sélection de tous les acteurs des données
Commencez par nommer un Chief Data Officer (CDO) qui sera responsable de la gouvernance des données dans toute l'entreprise. Il approuve les projets et les classe par ordre de priorité, gère les budgets, recrute le personnel pour le programme et assure une documentation complète. Idéalement, le CDO devrait être directement subordonné au CEO. Si votre entreprise est plus petite, vous pouvez attribuer ce rôle à un autre cadre supérieur d'un niveau comparable.
Élargissez ensuite l'équipe de projet en créant un groupe multidisciplinaire avec les profils suivants :
- Propriétaire des donnéesIls supervisent les données dans un domaine spécifique et contrôlent les processus pour garantir la collecte, la sécurité et la qualité des données. Ils déterminent la manière dont les données sont utilisées pour résoudre un problème particulier. Ainsi, le directeur du marketing peut être le propriétaire des données relatives aux clients ou le directeur des ressources humaines peut être le propriétaire des données relatives aux informations internes sur les employés.
- Responsable des donnéesIls sont les coordinateurs de données et les administrateurs de l'entrepôt central de données. Ils sont responsables de l'organisation et de la gestion de toutes les données ou d'une unité de données spécifique et veillent au respect des directives et des règles. Ils saisissent et corrigent les éléments de données, évitent les doublons et vérifient la qualité des bases de données.
- Gestionnaire de donnéesCelui-ci veille au bon cycle de vie des données en autorisant et en contrôlant l'accès aux données, en définissant des processus techniques pour garantir l'intégrité des données et en effectuant des contrôles pour la sauvegarde et l'archivage des données et des modifications qui leur ont été apportées.
5. éliminer les silos de données
Une fois que vous avez constitué votre équipe de projet de gouvernance des données, vous pouvez la réunir au sein d'un comité qui prend des décisions stratégiques sur la mise en œuvre dans les différents domaines d'activité. Ce comité approuve les politiques de données et traite de toutes les questions relatives à la gestion, à la sécurité et à la qualité des données. Organisez également des réunions régulières avec la possibilité de donner un feedback.
Idéalement, vous devriez opter pour une gouvernance horizontale, en plaçant les données au centre de vos activités et de vos affaires. Sur la base de ce principe, vous pouvez par exemple accélérer l'élimination des silos entre le marketing direct, la publicité et le service à la clientèle et réunir l'expertise et les technologies CRM et médias au sein des entreprises, des marques et de leurs agences. Informez vos collaborateurs des avantages de la collaboration et de l'échange de données au quotidien.
Assurez-vous ensuite que toutes les données utiles à la réalisation des projets sont consolidées sur une plateforme de gestion des données qui garantit la fiabilité et la mise en relation des données. Il est important de faire prendre conscience à toutes les équipes de l'existence d'une base de données centralisée. Cela permet de créer une vision commune.
6. documenter le projet et les ressources
Pour réussir la mise en œuvre d'un projet de gouvernance des données, vous devez mettre en place des processus standard et trouver un langage commun au sein de l'organisation. Pour cela, mettez à disposition de vos équipes une "cartographie des données" : elle permet d'identifier les stocks de données, leurs flux, leur stockage et leurs méthodes de traitement. Vous rendrez ainsi les données accessibles et compréhensibles pour tous les collaborateurs.
Le dossier de données se compose d'un glossaire commercial avec des définitions précises de toutes les terminologies liées aux données en circulation. S'y ajoute un modèle qui montre la structure des données de l'entreprise et donne des informations sur leur stockage. Un diagramme de flux de données est également indispensable. Le dossier de données contient également une section sur le format des différents types de données et informe sur leurs conditions d'accès et d'utilisation.
7. assurer la qualité des données
Les données orientent la plupart de vos décisions, par exemple le type et le moment des mesures publicitaires ou des campagnes de communication, la segmentation des groupes cibles, la correction ou l'ajout de fonctionnalités sur un site web ou une application mobile. Dans ce contexte, vous devez pouvoir compter sur la qualité des données. En effet, des données de mauvaise qualité peuvent avoir de graves conséquences pour votre entreprise, comme une baisse des revenus, du trafic bloqué par des adblockers ou des conversions surestimées en raison d'une mauvaise attribution des sources.
Pour réduire ces risques, il convient d'être vigilant à toutes les étapes du cycle de vie des données, en commençant par le moment critique de la collecte des données. Toute modification ou mise à jour du site web ou du suivi représente un risque pour la qualité de la collecte. Mettez en place des méthodes et des outils efficaces pour gérer et documenter ce processus.
Veillez tout d'abord à ce que les balises soient correctement mises en œuvre dans vos plans de balisage. Vérifiez-les régulièrement et intégralement, idéalement à l'aide de tests d'acceptation automatisés, car l'exécution manuelle prend non seulement beaucoup de temps, mais augmente également le risque d'erreur.
8. garantir la conformité des données
Depuis la mise en œuvre du règlement général sur la protection des données (RGPD), les entreprises savent à quel point il est important de respecter la protection des données personnelles des utilisateurs sur leurs différentes plateformes numériques. En cas de violation, non seulement des sanctions sont encourues, mais cela peut également nuire à l'image de marque et entraîner une perte de confiance de la part des clients.
C'est pourquoi vous devez vous assurer, sur vos sites web et vos applications mobiles, que le consentement de vos visiteurs est recueilli correctement, librement et en connaissance de cause. À cette fin, vous devez choisir un fournisseur qui dispose d'une gestion rigoureuse des données et qui respecte pleinement les dispositions légales.
9) Démocratiser l'utilisation interne des données
La démocratisation des données au sein d'une entreprise est l'une des composantes élémentaires d'une approche de gouvernance des données. Il s'agit de mettre à la disposition des collaborateurs toutes les informations et ressources nécessaires à l'accomplissement de leurs tâches et à la création de valeur. Certaines mesures peuvent y contribuer, comme la définition des cas d'utilisation de ces données ainsi que l'indication de l'endroit où elles se trouvent et de la manière dont on peut y accéder. La nomination de référents pour les données, qui aident les utilisateurs au quotidien, s'avère également être une bonne idée dans la pratique.
Ensuite, vous devez mettre en place un programme de soutien spécifique. Vous pouvez par exemple organiser des formations et des ateliers internes pour guider les utilisateurs dans l'utilisation opérationnelle des outils et dans l'utilisation des données sur des sujets spécifiques. Pour inciter les collaborateurs à utiliser les données, l'équipe chargée des données peut également concevoir des tableaux de bord pour la gestion des différentes activités.
Auteur :
Adrien Guenther est directeur de l'analyse chez Piano sur le site de Munich, où il fournit depuis une dizaine d'années des conseils stratégiques aux entreprises de la région DACH en matière de planification et de mise en œuvre d'analyses numériques. Avant de rejoindre AT Internet (rachetée par Piano en 2021), Guenther était responsable du département Business Intelligence dans une agence de publicité. Il a également de l'expérience dans l'optimisation et le développement des moteurs de recherche, ainsi que dans le développement d'actifs numériques, de sites web et d'applications en ligne.